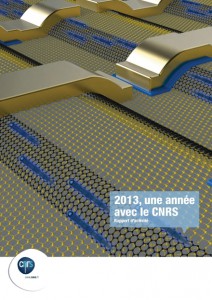RAPPORT SCIENTIFIQUE DU CNRS, JUIN 2014
QUAND LA COLORATION DES ÊTRES VIVANTS RÉVÈLE LEUR ÉVOLUTION
Des rayures du pelage du tigre au kaléidoscope chromatique des ailes des papillons, la diversité du règne animal en matière de coloration semble sans limite. Une étude réalisée par des généticiens français révèle pour la première fois les mécanismes génétiques qui sous-tendent l’apparition et la modification de tels motifs au fil de l’évolution. Leurs travaux se sont plus précisément focalisés sur la formation d’une tache de pigments noirs située à l’extrémité des ailes des mâles de plusieurs espèces de mouches drosophiles. Dans un premier temps, les scientifiques se sont intéressés à l’apparition de cette tache, il y a environ 15 millions d’années, chez un ancêtre des espèces tachetées actuelles. Ils ont ainsi constaté que des mutations apparues dans la séquence de gènes responsables de la coloration noire, qualifiés d’« artisans », ont rendu ces derniers réceptifs aux instructions d’un gène « architecte » actif exclusivement au bout de l’aile de l’insecte. « Cela montre que cette innovation évolutive qu’est la tache sur l’aile résulte non pas de l’apparition de nouveaux gènes mais de l’émergence de nouvelles interactions entre des gènes préexistants », résume Benjamin Prud’homme de l’Institut de biologie du développement de Marseille Luminy1. Une fois la tache formée, elle s’est ensuite plus ou moins intensifiée, étalée, ou a même éclaté en plusieurs petites taches. Cette phase de diversification, coïncidant avec l’apparition de nouvelles espèces, résulte cette fois d’une extension de l’expression du gène « architecte » précédent à d’autres régions de l’aile. En dévoilant ce double processus d’apparition et de diversification à l’origine de la formation puis de l’évolution de simples taches, les chercheurs ont franchi une étape importante vers la compréhension des mécanismes génétiques qui façonnent la morphologie des espèces. « Cette transition évolutive en deux temps est très certainement transposable à toutes sortes d’autres traits, qu’il s’agisse de l’aspect d’une tache ou d’une rayure, de la forme d’un membre ou de celle d’un organe interne », conclut Benjamin Prud’homme.
- CNRS/Aix-Marseille Université.
Science
Mars 2013
LES BACTÉRIES NE COOPÈRENT QU’ENTRE VOISINES
Les exemples de coopération sont légion dans le monde vivant. À l’image des insectes sociaux, certains microorganismes bactériens s’entraident eux aussi pour accéder plus facilement aux ressources de leur environnement. Les rouages de cette forme de coopération particulière, dénuée de prise de décision, restent néanmoins obscurs. Pour tenter d’en savoir plus, des chercheurs issus de trois laboratoires1 se sont intéressés au développement de colonies de Pseudomonas aeruginosa. Leurs travaux révèlent qu’une des molécules nécessaires au développement de ces bactéries est échangée de voisine à voisine. Pour récupérer le fer nécessaire à leur croissance, les bactéries sécrètent des molécules, appelées sidérophores. Dotées d’un coefficient de diffusion élevé, ces molécules devraient se disséminer rapidement et de manière homogène dans leur environnement. Les scientifiques se sont aperçus que c’était le contraire. En observant un sidérophore naturellement fluorescent, ils ont mesuré, à l’échelle cellulaire, la dynamique de sa répartition au sein de la colonie. « Nous avons constaté que, contrairement à ce qu’on imaginait, celui-ci n’est pas distribué de manière homogène dans la colonie mais réparti de manière dynamique, suggérant un échange entre cellules productrices », résume Nicolas Desprat, du Laboratoire de physique statistique de l’École normale supérieure. Ce mécanisme, confirmé par un modèle et des expériences, favoriserait ainsi le développement des consœurs aux dépens d’éventuelles tricheuses tentées d’utiliser les molécules produites sans en sécréter elles-mêmes. Les chercheurs veulent désormais identifier les mécanismes à l’origine de ces échanges. « Il serait alors possible d’agir au niveau des communications bactériennes pour stopper la croissance de la colonie », anticipe Nicolas Desprat. Pseudomonas aeruginosa étant responsable de la majorité des infections nosocomiales2, une telle stratégie permettrait ainsi de contrecarrer la résistance progressive de ces infections aux antibiotiques censés les traiter.
- Laboratoire de physique statistique (CNRS/ENS/UPMC/Université Paris Diderot) ; Institut de biologie de l’École normale supérieure (ENS/CNRS/Inserm) ; laboratoire Biotechnologie et signalisation cellulaire (CNRS/Université de Strasbourg).
- Infection contractée dans un établissement de santé
Proceedings of the National Academy of Sciences
Juillet 2013
LES ESPÈCES RARES ASSURENT DES FONCTIONS PRÉCIEUSES
Régulièrement placées sous le feu des projecteurs à cause de leurs forts taux d’extinction, les espèces rares sont paradoxalement considérées comme peu utiles au bon fonctionnement des écosystèmes. Une équipe internationale1 démontre pour la première fois que certaines de ces espèces rares jouent en fait un rôle écologique unique y compris dans les écosystèmes les plus diversifiés. Pour arriver à cette conclusion les scientifiques ont d’abord répertorié les traits fonctionnels de 846 espèces de poissons de récifs coralliens, 2 979 espèces de plantes alpines et 662 espèces d’arbres tropicaux. « Ces informations qui englobent des données telles que la morphologie, le rythme biologique ou le régime alimentaire de ces espèces servent à déterminer leurs fonctions écologiques », explique David Mouillot, de l’unité Écologie des systèmes marins côtiers de Montpellier. Au sein de ces trois grands systèmes, les scientifiques ont ensuite cherché à déterminer si les fonctions les plus originales étaient assurées par les espèces communes ou les espèces rares. « Sur l’ensemble de ces écosystèmes particulièrement riches, notre analyse démontre que la plupart des rôles uniques sont joués par les espèces rares, suggérant ainsi leur utilité dans le maintien à long terme du fonctionnement des écosystèmes », souligne David Mouillot. L’exemple de la murène géante javanaise est à ce titre emblématique. En se nourrissant de cadavres et d’animaux malades qu’elle traque dans les moindres interstices du récif corallien, cette espèce accélère le recyclage des nutriments et participe à la bonne santé de l’écosystème corallien. Parce qu’elles sont essentiellement portées par des espèces rares qui sont vulnérables, de telles fonctions clés ont de grandes chances de disparaître en cas de changements environnementaux majeurs. Dans ce contexte, mener une politique de conservation de la nature tenant compte de la rareté fonctionnelle permettrait de préserver l’ensemble des fonctionnalités des écosystèmes tout en limitant l’impact des perturbations qui les affectent.
- Plusieurs laboratoires et unités de recherche réunissant des chercheurs du CNRS, de l’université Montpellier 2, de l’Inra, de l’EPHE et de l’IRD ont contribué à cette étude.
Plos Biology
Mai 2013
ATMOSPHÈRE ET CROÛTE TERRESTRE SONT APPARUES DE CONCERT
Une grande partie de la croûte et de l’atmosphère terrestres actuelles étaient déjà présentes il y a 3,5 milliards d’années. C’est ce que révèlent deux études d’une équipe francobritannique1. Pour réaliser cette double découverte, les scientifiques ont analysé la composition de quartz australiens âgés de 3,5 milliards d’années. « Ces roches ont emprisonné dans des inclusions fluides microscopiques l’eau et les gaz atmosphériques formés à cette époque », précise Bernard Marty, du Centre de recherches pétrographiques et géochimiques de Nancy. Déterminer les caractéristiques géochimiques de ces inclusions donne ainsi accès aux propriétés de l’environnement terrestre aux temps les plus reculés. En irradiant des échantillons de ces roches ancestrales, les géochimistes ont tout d’abord mesuré la concentration des différents isotopes de l’argon, un élément chimique intimement lié à l’histoire de la formation de la croûte terrestre. Leur analyse révèle qu’en ces temps anciens, le rapport 40Ar/36Ar était inférieur seulement de moitié à sa valeur actuelle. « En intégrant cette donnée dans un modèle de croissance de la croûte terrestre au cours du temps, nous avons pu déterminer que 80 % de la croûte se serait formée entre 3,8 et 2,7 milliards d’années », poursuit le chercheur. L’analyse des bulles d’eau piégées dans ces mêmes quartz australiens a par ailleurs permis de déterminer la pression et la composition isotopique du diazote, qui forme 78 % de l’atmosphère actuelle, dans l’atmosphère primordiale. Les scientifiques ont ainsi constaté que la valeur de ces deux paramètres n’avait presque pas évolué depuis 3,5 milliards d’années. Selon Bernard Marty, « la présence, depuis cette période, d’un champ magnétique d’une intensité au moins égale à la moitié de celle du champ magnétique actuel permettrait d’expliquer une telle stabilité de notre atmosphère au cours du temps ». En contribuant à améliorer la compréhension de la dynamique géologique de notre planète aux premières heures de son existence, ces résultats devraient notamment permettre de mieux cerner les circonstances de l’apparition de la vie sur Terre.
- Centre de recherches pétrographiques et géochimiques de Nancy (CNRS/Université de Lorraine) ; Université de Manchester (Royaume-Uni) ; Institut de physique du Globe de Paris (CNRS/Université Paris Diderot/Sorbonne-Paris Cité).
Nature & Science Express
Juin 2013 et septembre 2013